 |
|
|
HISTORIQUE Origines Après
les troubles politiques de 1798, la ville de Berne se rapprocha
de sa campagne en invitant à la fête du 17 août
1805 trois mille citadins et campagnards ainsi que des hôtes
de toute l'Europe dans la prairie d'Unspunnen, à Interlaken.
C'est par cette fête, en effet, que les Bernois reprirent,
d'une part, conscience de la nécessité de "Zur Ehre des Alphorns" ( A la gloire du cor des Alpes) fut la devise inscrite sur la médaille commémorative. La fête elle-même fut brillante mais, ce que l'eau-forte du miniaturiste F.N. König et la chronique attestent, deux joueurs seulement se produisirent au concours de cor des Alpes et remportèrent sans concurrence les deux prix : deux médailles et deux moutons noirs. Il
faut noter qu'à cette époque, le Romantisme eut
un effet considérable sur l'appréciation des cultures
autochtones: alors que les frères Grimm travaillaient sur
les contes et légendes populaires, les premiers "collecteurs"
de musiques traditionnelles se mirent au travail à travers
l'Europe dans l'effort de conserver et de faire revivre les traditions
locales de chaque région et de chaque pays. C'est dans
cet esprit que les fêtes suisses furent célébrées,
et pourquoi elles résonnèrent si bien chez les populations
urbaines qui voulaient se ressourcer dans leurs traditions ancestrales.
Le Cor aujourd'hui La
confrérie des joueurs de cor des Alpes compte actuellement
environ 1500 membres, citadins et campagnards, qui s'exercent
d'après des mélodies notées. L'Association
fédérale des yodleurs, fondée en 1910, elle
aussi organisa des cours qui contribuèrent à la
diffusion de l'instrument, que des amateurs pratiquent aujourd'hui
dans toute la Suisse et à travers le monde. Une normalisation
de l'accord permet de jouer à deux, trois, quatre et plus. FACTURE Le cor des Alpes est une longue trompe conique
en bois, sans trous, ni clefs, ni pistons, se terminant par un
pavillon incurvé. Une embouchure facilite la transmission
des vibrations des lèvres. Cet instrument ne produit que
des harmoniques naturels, à savoir 13 à 22
notes sur 3 à 4 octaves, selon l'habileté du souffleur.
Aujourd'hui,
de nombreux facteurs de cors préfèrent le façonnage
d'une pièce de bois de choix, adaptable au tube rectiligne.
Une épaisseur régulière de quatre à
sept millimètres confère à l'instrument une
sonorité équilibrée. Les deux moitiés
évidées sont rectifiées au rabot, polies,
puis réunies. Le facteur de cor des Alpes consacre plus
de 50 heures au seul évidage de l'intérieur et
jusqu'à 100 heures à la réalisation artisanale
de l'instrument, coupe de bois non L'évolution des techniques a favorisé l'émergence de nouvelles formes de cor des Alpes. Roger Zanetti a transformé cet instrument en un objet de haute technologie en mettant au point un cor des Alpes en fibre de carbone. Primé au salon des inventions de Genève en 1999, ce cor high tech offre plusieurs avantages : le carbone vibre de la même façon que le bois et l'assujettissement des différents tubes télescopiques se fait par adhérence, sans aucune bague. Il est léger et peu encombrant. Il offre surtout la possibilité au musicien de pouvoir jouer une multitude de tonalités. Le reste est une affaire de goût et de choix personnels. Les musiciens de l'ensemble Hornroh ont développés de nouvelles formes de cor des Alpes qu'ils nomment Alpophone et autres Alperidoo.
Utilisé aussi pour appeler le bétail, ou pour l' apaiser pendant la traite, cette fonction initiale a aujourd'hui disparu, et l'instrument est joué par des amateurs pour leur divertissement. Le
répertoire est constitué de pièces d'ensembles
( Duos, Trios, Quatuor ). Dans le domaine de la musique symphonique
on le trouve pour la première fois dans la Des musiciens de jazz comme Hans Kennel, l'ensemble Mytha, l'ensemble Hornroh, le duo Stimmhorn, et bien d'autres expériences encore, démontrent que le répertoire pour cor des Alpes est en pleine évolution, grâce à l'utilisation de nouveaux modes de jeu.
 Cor'Alpes joue à Menton (Var) dans le cadre des fêtes de nouvel an ( janvier 2004 )
|
|

 s'unir,
de l'autre, qu'ils reprirent goût aux jeux des bergers:
lutter, lever des pierres, faire de la musique. Et c'est par cette
fête que le cor des Alpes commença à retrouver
la place qu'il avait perdue dans le coeur des Suisses.
s'unir,
de l'autre, qu'ils reprirent goût aux jeux des bergers:
lutter, lever des pierres, faire de la musique. Et c'est par cette
fête que le cor des Alpes commença à retrouver
la place qu'il avait perdue dans le coeur des Suisses.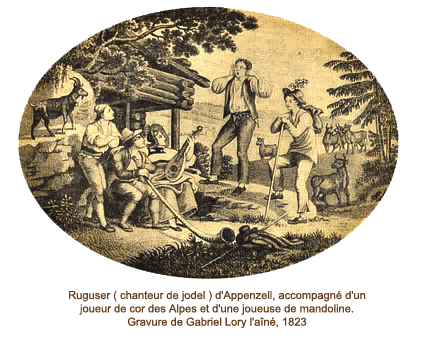 L'artiste-peintre
König nota dans son journal, en 1814, à l'occasion
d'une promenade au canton de Berne: "Vom Alphorn sieht
und höret man fast nichts mehr..." ("De
cor des Alpes on ne voit ni n'entend plus rien..." )
En effet, il fut nécessaire que le maire de Berne priât
un jeune professeur de musique qui jouait du cor des Alpes comme
Ingres de son violon d'enseigner le jeu de cet instrument. On
construisit donc rapidement des instruments, on composa des morceaux
et on organisa des cours qui eurent lieu à Grindelwald
dès 1826; l'artiste-peintre G. Vollmar en fit d'ailleurs
un tableau. L'idée de sauver la tradition du cor des Alpes
par l'enseignement donna naissance à l'instruction populaire
qui ne se fait pas aux académies mais aujourd'hui encore
le dimanche après-midi dans les prés et les forêts.
L'artiste-peintre
König nota dans son journal, en 1814, à l'occasion
d'une promenade au canton de Berne: "Vom Alphorn sieht
und höret man fast nichts mehr..." ("De
cor des Alpes on ne voit ni n'entend plus rien..." )
En effet, il fut nécessaire que le maire de Berne priât
un jeune professeur de musique qui jouait du cor des Alpes comme
Ingres de son violon d'enseigner le jeu de cet instrument. On
construisit donc rapidement des instruments, on composa des morceaux
et on organisa des cours qui eurent lieu à Grindelwald
dès 1826; l'artiste-peintre G. Vollmar en fit d'ailleurs
un tableau. L'idée de sauver la tradition du cor des Alpes
par l'enseignement donna naissance à l'instruction populaire
qui ne se fait pas aux académies mais aujourd'hui encore
le dimanche après-midi dans les prés et les forêts.
 Les
premières représentations graphiques nous montrent
un instrument petit et joué à bout de bras.
Les
premières représentations graphiques nous montrent
un instrument petit et joué à bout de bras.  comprise.
Le cor des Alpes en fa dièse/ sol bémol actuellement
le plus courant, mesure environ 340 cm et se scinde en deux ou
trois parties, assemblées par emboutissage ou filetage
de laiton. Pour les protéger des intempéries et
leur assurer une longévité prolongée, le
cor des Alpes est depuis toujours cerclé. Aujourd'hui le
cor des Alpes est plus fréquemment gainé de rotin.
On utilise aussi , mais plus rarement, l'écorce de bouleau
prélevée sur le côté ensoleillé
de l'arbre, quand la sève monte à la veille de l'été.
Le pavillon du cor des Alpes, par contre, est fréquemment
décoré d'une sculpture, pyrogravure, peinture rustique,
marqueterie ou décalcomanie. Sujets privilégiés:
croix fédérale, fleurs des Alpes, chalets d'alpage
ou chaîne de montagnes. Les cors des Alpes actuels sont
pourvus d'une embouchure tournée dans le buis et fort souvent
sculptée.
comprise.
Le cor des Alpes en fa dièse/ sol bémol actuellement
le plus courant, mesure environ 340 cm et se scinde en deux ou
trois parties, assemblées par emboutissage ou filetage
de laiton. Pour les protéger des intempéries et
leur assurer une longévité prolongée, le
cor des Alpes est depuis toujours cerclé. Aujourd'hui le
cor des Alpes est plus fréquemment gainé de rotin.
On utilise aussi , mais plus rarement, l'écorce de bouleau
prélevée sur le côté ensoleillé
de l'arbre, quand la sève monte à la veille de l'été.
Le pavillon du cor des Alpes, par contre, est fréquemment
décoré d'une sculpture, pyrogravure, peinture rustique,
marqueterie ou décalcomanie. Sujets privilégiés:
croix fédérale, fleurs des Alpes, chalets d'alpage
ou chaîne de montagnes. Les cors des Alpes actuels sont
pourvus d'une embouchure tournée dans le buis et fort souvent
sculptée.  "Sinfonia
Pastorella" de Leopold Mozart (1755). Des références
au "
"Sinfonia
Pastorella" de Leopold Mozart (1755). Des références
au "